Réconfort et vieilles dentelles
Doc7730/04/2019Marcia - I
Je m'étais retrouvé veuf brutalement. Ma femme avait une santé fragile, mais tout de même, je ne m'étais hélas pas attendu à ça. Le pire est que nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison, que nous venions juste d'acheter ; je me retrouvai d'un seul coup seul dans cette demeure où nous avions tout juste eu le temps de poser nos meubles, de défaire nos valises, de vider nos cartons et de ranger nos affaires.
Trois mois, c'était tellement court que les choses n'avaient pas encore pris leur tournure définitive. Je restais abasourdi, sans aucune envie d'aller plus loin dans l'installation que nous avions commencée petit à petit, laissant sur place les projets que nous avions élaborés chaque jour. Je n'avais plus aucune envie de bricoler, j'avais envie de ne rien faire. La vaisselle s'accumulait plusieurs jours dans l'évier, et souvent je dînais à l'extérieur, tristement, retardant le moment de rentrer pour retrouver ma maison vide, en tout cas sans elle.
L'été arrivait ; le jardin était ensoleillé, mais j'avais peu de courage. Je me forçais à entretenir les fleurs qu'elle avait plantées, mais je laissais en standby tout aménagement supplémentaire.
J'évitais de me laisser aller, voulant rester fidèle à la promesse que je lui avais toujours faite de continuer à vivre même sans joie et sans bonheur, hormis quelques samedis où je me faisais une soirée whisky et photos (je regardais nos photos et nos vidéos, triste à en crever, me saoulant la gueule et pleurant, seul et tranquille car sans personne pour me voir).
Je faisais du sport, le plus souvent possible le soir, histoire de voir des gens et d'occuper mes soirées pour éviter de rester à me morfondre enterré vivant, comme un rat. Et puis les nuits, quand j'arrivais à dormir, il y avait les rêves, tellement douloureux quand on voit son aimée qui semble tellement vivante, tellement réelle, qui vous parle, avec la terrible déconvenue le matin au réveil.
Puis sont venus des rêves érotiques, parce qu'on en reste pas moins un homme, et la nature, le corps, la libido enfouie et muselée doivent s'exprimer. Quelquefois des rêves avec elle, douloureux souvenirs de son corps, de nos étreintes, puis de plus en plus – et heureusement – avec d'autres femmes, des inconnues parfois, au visage flou, puis plus rarement avec des femmes entrevues ou fréquentées.
Ça fait bizarre au début, mais au moment où l'on se réveille avec la gaule, on se dit qu'on est encore vivant !
La première fois, c'était la directrice d'une société qui était autrefois dans mon portefeuille clients, une blonde, la quarantaine. Je la trombinais assise sur le fauteuil de cuir de son bureau. Ce qui était bizarre, c'est qu'elle n'était du tout mon type de femme : moi qui aime les femmes pulpeuses, voire rondes et même très rondes, je limais cette femme toute chétive, limite anorexique, et j'y prenais du plaisir !
Elle n'avait même pas de seins, à peine deux bourgeons (on aurait dit la poitrine d'une préadolescente), des bras et des cuisses grêles, même si elle ne manquait pas d'élégance. C'est vrai que son faible poids – elle ne devait pas peser plus de 45 kilos d'après mon souvenir – faisait que je la maniais en la portant, la montant et la descendant sur ma queue comme une poupée de chiffon, et j'aurais presque pu sentir ma pine à travers la paroi de son vagin en lui palpant le pubis.
Je la tringlais, l'enfilais, la pilonnais, l'empalais en cadence sur mon membre dressé et elle se faisait secouer en criant comme une folle. Mes couilles claquaient sur ses petites fesses maigrichonnes, mes mains emprisonnant sa taille à peine plus large qu'un tronc de bouleau, et elle dégoulinait comme une salope, m'inondant les cuisses de sa mouille. Une vraie chienne ! Je la secouais de haut en bas, de bas en haut, et je voyais ses cheveux blonds coupés au carré s'agiter dans tous les sens.
Au réveil, j'avais la queue raide et dure comme du bois, et je dus me branler comme un malade, envoyant un jet de sperme à un mètre.
L'avantage d'être seul, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut.
Après ce genre de rêve, j'avais toute la journée des images salaces en tête et j'étais un peu moins triste, me sentant légèrement ragaillardi.
C'est drôle, la réaction des gens quand vous vous retrouvez veuf. Il y en a qui semblent vouloir vous ménager, prenant un air de pitié et de commisération. D'autres qui s'en foutent. D'autres encore qui vous évitent comme si le malheur était contagieux, ou comme s'ils avaient peur d'être confrontés à la douleur et au chagrin d'autrui parce qu'ils ne savent ni quoi dire, ni comment se comporter avec vous. Et je ne parle pas des amis.
Et puis souvent on est surpris. La compassion et la main tendue, la sympathie viennent de gens que vous connaissez à peine, que vous n'avez quasiment pas côtoyés. C'est ainsi qu'un jour, en fin d'après-midi où j'étais rentré tôt du boulot, on sonna. Je fus surpris de découvrir devant mon portillon Marcia, l'agent immobilier qui nous avait trouvé cette maison. J'allai lui ouvrir, l'air un peu ahuri (comme j'avais tendance à être depuis ces quelques mois) et l'accueillis néanmoins avec le sourire.
— Bonjour, Marcia.
— Bonjour. Vous vous souvenez de moi ?
— Bien sûr, Marcia. Comment pourrais-je vous avoir oubliée ?
— J'ai appris pour votre femme. Je suis désolée. Je voulais vous présenter mes condoléances, même si ça fait tard mais on me l'a appris il y a très peu de temps…
— Je vous en prie. Enfin, je vous remercie ; vous ne pouviez pas savoir. Mais c'est très gentil de votre part…
— Comme je passe tous les soirs tout près de chez vous pour rentrer du bureau, j'ai voulu venir vous voir pour savoir comment vous alliez.
— C'est vraiment très gentil. Ça me touche beaucoup. Mais je vous en prie, ne restez pas à la porte, entrez.
Je me rappelais en effet qu'elle habitait la commune juste à côté puisqu'elle nous l'avait dit (elle avait même essayé de nous vendre une maison dans son coin mais nous n'aimions pas l'endroit parce que trop isolé).
Nous nous installâmes dans la cuisine ; je lui proposai un café qu'elle accepta. Elle me fit remarquer les changements que nous avions eu le temps de faire dans la décoration. Cela lui plaisait beaucoup. Je lui dis que c'étaient surtout des idées de ma femme. Elle me dit qu'elle avait beaucoup de goût. Je lui répondis que oui, en effet, et que je me doutais que ça lui plairait puisque, vu son bureau à l'agence qu'elle avait décoré elle-même, elle aussi montrait un goût certain. D'ailleurs ma femme, à l'époque, le lui avait fait remarquer. Oui, elle s'en souvenait.
Elle eut des mots très gentils, très justes. Me disant que c'était une femme bien, agréable, et que comme tout être elle était irremplaçable, qu'elle devait manquer à beaucoup de monde, à moi en premier bien entendu, mais aux autres aussi. Elle dit qu'on n'a pas besoin de connaître beaucoup certains êtres pour savoir qu'elles sont des personnes de qualité. Elle se souvenait qu'elle partageait avec elle des origines communes, mais ce n'était pas que pour ça.
— Non, bien sûr, lui dis-je, moi non plus je ne vous connais pas beaucoup mais je sais que vous êtes quelqu'un de bien.
Elle protesta un peu.
— Vous avez du cœur, et j'apprécie cette qualité chez les gens. Je sais que vous avez du cœur sinon vous n'auriez pas fait ce geste de venir me voir pour prendre de mes nouvelles alors que rien ne vous y obligeait.
Elle sourit tristement, me fixa de ses yeux bleus perçants et posa sa main sur mon bras.
— Mon pauvre, ça doit être tellement dur pour vous…
Elle se souvenait combien nous avions l'air uni, mon épouse et moi. Elle aussi était mariée depuis près de 20 ans, et quand elle voyait un couple elle savait reconnaître l'amour qui existe entre ses membres. Elle n'avait pas que de l'expérience dans le domaine de l'immobilier.
Je souris. Je l'imaginai à ce moment-là en conseillère matrimoniale ; ça lui serait bien allé. Elle était élégante, toujours vêtue d'une façon correcte et en accord avec son âge (elle devait avoir entre 55 et 60 ans, bien que son visage commençât à être un peu buriné comme celui des femmes qui se sont trop exposées au soleil, ce qui peut les faire paraître un peu plus âgées), et son air toujours très calme avait quelque chose d'apaisant et assez gracieux.
Ne répondant pas à ce qui pouvait passer pour une question, je posai mon autre main sur son avant-bras et lui dis :
— Qu'est-ce que vous voulez, c'est le sort de tous les couples, tôt ou tard. Ça arrive souvent tard, mais parfois c'est beaucoup trop tôt, ce qui nous enlève l'autre dans la force de l'âge. En tout cas je suis vraiment très touché que vous soyez passée.
Je ne savais pas quoi ajouter, mais l'émotion montait en moi, ce qui se faisait entendre dans ma voix un peu tremblante, et mes yeux s'humidifiaient. Ce n'était pas feint. Son geste et son intention faisaient mouche, surtout en comparaison avec tant d'indifférence de la part de gens que j'avais cru proches de moi avant cette épreuve, dont je n'avais rien attendu mais dont j'avais constaté en tout cas l'absence.
Elle resta une petite demi-heure avec moi et nous parlâmes de choses et d'autres, de la maison, de ses affaires. Sa présence me faisait chaud au cœur. Je ressentais de la tendresse pour cette petite femme qui se montrait chaleureuse et empathique alors que je la connaissais si peu. J'avais presque envie de l'embrasser.
Elle finit par prendre congé ; je la raccompagnai à la porte. Je lui serrai la main, la remerciant encore du fond du cœur de s'être préoccupée de moi, lui faisant bien comprendre que bien qu'elle était pour moi une presque inconnue, sa présence m'avait fait du bien.
— Je vous en prie, dit-elle. Je repasserai vous voir ; je finis souvent tard… Enfin, si ça ne vous dérange pas.
— Vous ne me dérangerez absolument pas ; ce sera avec plaisir, comme aujourd'hui. Merci encore.
Bien entendu, je ne crus pas une seconde qu'elle reviendrait me voir. Elle avait eu un geste d'humanité envers moi, sans doute émue par mon malheur, tellement banal, hélas. Mais comme tout le monde, une fois prise par son quotidien, son travail, ses préoccupations journalières, elle me mettrait dans un coin de sa mémoire avec le sentiment d'avoir fait aujourd'hui ce qu'elle devait faire, se disant que je survivais, me sachant par ailleurs à l'abri du besoin et des problèmes matériels, et que je souffrais seulement de mon deuil et de ma solitude, tout comme des milliers d'autres gens.
Marcia était une bonne commerciale, avec une dose d'empathie et de souci de l'autre allant au-delà de ce qu'on demande professionnellement aux commerciaux. Mais une fois la vente conclue elle passait aux clients suivants, et je me disais que si je ne m'étais pas retrouvé veuf peu après cette vente et si elle ne l'avait pas appris fortuitement, je ne l'aurais sans doute jamais revue, sauf peut-être par hasard, la croisant dans la rue de son agence ou dans un magasin, bonjour-bonsoir.
Elle avait eu le courage de venir me voir, affrontant ma tristesse, m'offrant un peu de son temps pour me soutenir et me délivrer des paroles de réconfort, ce qui me semblait déjà beaucoup. Je ne lui demandais rien de plus, je n'attendais pas d'elle qu'elle revienne comme elle l'avait promis. Si elle ne revenait pas – ce dont j'étais persuadé – je n'aurais vraiment aucune raison de lui en vouloir. Elle n'était ni une proche ni une amie.
Deux-trois mois s'écoulèrent, un peu mornes. J'essayais d'avancer, de continuer à m'installer, à aménager ma maison à mon goût et à ma convenance. Je commençais à imaginer de vagues projets. Il allait falloir penser à ce que j'allais faire durant mes congés d'hiver qui allaient arriver dans 6 ou 7 mois ; partir, certainement (pas question de rester seul ici une semaine durant).
Un soir de semaine, vers 18 h 30, j'étais à la maison et n'attendais personne quand on sonna.
Surprise : c'était Marcia à la porte. J'allai lui ouvrir avec un grand sourire qu'elle me rendit très gentiment. Cette fois je la fis entrer sans lui poser la question du pourquoi de sa visite. Nous nous assîmes dans la cuisine et je lui proposai un apéro.
Elle me demanda comment j'allais. J'avais l'air moins triste, c'est sûr. Pas enjoué, évidemment. On ne peut pas dire que je pétais la forme, mais je faisais bonne figure. Elle me félicita pour mon courage.
Je lui parlai des transformations que j'avais en projet. Je lui demandai comment allait son boulot. Difficilement, à cause du contexte économique : il y avait des acheteurs mais les banques prêtaient peu, les crédits étaient difficiles à obtenir. Malgré tout elle arrivait à garder une bonne qualité de vie, tâchant de ne pas rentrer trop tard chez elle, comme ce soir (ce qui lui avait permis de venir passer un peu de temps avec moi – j'étais flatté). Elle essayait de se ménager, n'étant pas prête à se défoncer pour le boulot (pour obtenir quels résultats ?) et préférait établir de bonnes relations, des rapports cordiaux – presque amicaux – avec ses clients : les gens aiment ça, et ça marche aussi bien.
Je ris. En effet, j'en étais témoin et j'appréciais. Je n'osai pas blaguer et lui parler de service après-vente, ce qui aurait été déplacé car elle ne gagnait rien en venant me voir (en plus, elle n'était qu'employée de cette agence) ; elle le faisait simplement par sympathie, et c'était très agréable.
Marcia n'était pas dénuée de charme avec son port de tête droit qui lui donnait un air un peu fier (ce n'était qu'une apparence), ses yeux bleus perçants, sa coiffure brune, souple et impeccable dénuée de tout cheveu blanc ; sa courtoisie et ses manières semblaient presque d'une autre époque. Elle parlait toujours d'un ton égal, calme, avec douceur et franchise ; elle respirait la sincérité. Elle portait toujours des chemisiers simples mais habillés et des pantalons de ville, souvent des bottes, comme aujourd'hui. La classe, le bon goût, sans faire trop chic.
On pouvait dire qu'elle s'était choisi une tenue vestimentaire sobre, sérieuse, mais qui mettait le client à l'aise. Je pense aussi qu'elle avait compris que dans ce métier il ne faut pas faire trop friqué, ce qui pourrait effrayer les chalands en les laissant penser que l'agence se sucre bien avec la commission.
Mais en tant que femme – si on faisait abstraction de la professionnelle –, c'était un style qui me plaisait, pas trop féminin (pas pute, comme certaines de sa profession que j'avais connues, avec un décolleté outrageant, les nichons par-dessus bord et la jupe ras-le-bonbon, exhibant des cuisses dorées au soleil des tropiques ou des cabines d'UV, et elles n'étaient pas spécialement parmi les plus jeunes femmes, ce n'était pas une question d'âge), pas trop austère ni coincé, mais assez femme pour que l'homme ait envie de la regarder comme une femme, mûre certes, mais une femme encore.
Dans la conversation, quand le silence commençait à s'installer, je la remerciais encore chaleureusement de l'égard qu'elle avait pour moi, lui exprimais encore combien j'étais touché par sa sollicitude envers moi, du souci qu'elle avait de s'enquérir de comment je me remettais de la perte de ma femme. Je lui dis qu'elle était une femme de cœur, que c'était tellement rare, et que j'appréciais beaucoup les gens comme elle.
Elle sourit légèrement en me disant avec modestie qu'elle ne méritait pas tant de remerciements, qu'elle n'agissait pas ainsi avec tous ses anciens clients, que si elle le faisait avec moi c'était parce qu'elle avait été touchée par cet évènement tragique et parce que je lui étais sympathique, et même attachant. Elle répéta le mot « attachant » avec sérieux, me fixant de ses beaux yeux avec gravité, comme pour donner toute l'importance à son sentiment.
J'étais tout chose. Je ne savais plus que dire. Je balbutiai quelques mots, cherchant à retrouver une contenance. Elle m'avait remué profondément. C'était un mélange d'émotion, de sensation d'affection envers elle et de gratitude, mais aussi une sensation trouble qui remontait de mon ventre. C'était la première femme depuis longtemps qui m'exprimait de la tendresse en toute simplicité et toute sincérité.
Je ne sais pas si elle se rendait compte du trouble qu'elle avait fait naître en moi. Je n'étais qu'un homme ; elle, elle était une femme d'un certain âge (avec un mari plus âgé encore, elle me l'avait dit) qui n'avait peut-être plus de libido, comme c'est parfois le cas à cet âge (même si je pouvais me tromper). Mais moi, à cinquante ans, le manque de la présence et du contact d'une femme, d'un corps féminin, me taraudait déjà depuis de longs mois ! Je débitai quelques banalités sur le temps, le jardin et ce qu'il y aurait à y faire dans les prochains jours.
Elle finit par se lever pour prendre congé. Je devais avoir les yeux brillants d'émotion. À ce moment-là je lui dis « Encore merci, Marcia. » Je ne sais pas si elle avait écarté les bras ou si je crus le voir, en tout cas, croyant percevoir ce signal, tout naturellement je tendis les bras vers elle et elle me prit dans ses bras, me serrant contre son corps.
Je lui exprimai ma gratitude ainsi, sans réfléchir, instinctivement et naturellement, et j'enfouis ma tête dans son cou. Mes mains descendirent toutes seules de son dos à sa taille menue que j'enlaçai avec un plaisir incommensurable. Je respirai profondément le parfum de son cou, où se mêlaient à son eau de toilette légère le parfum de sa peau chaude, de sa peau de femme, cette odeur, bien qu'unique, que j'accueillis avec un infini bonheur, comme si elle m'était familière, comme si j'en avais été sevré depuis très longtemps.
La réaction de mon corps fut immédiate et tellement prévisible, faisant suite à cette émotion qui m'étreignait depuis dix minutes et en avait été le déclencheur : j'eus une brutale et intense érection. C'était violent et irrépressible ! Ma queue dure et tendue au maximum était plaquée contre son ventre, et le pire, c'est que je n'en étais même pas gêné : elle n'était pas une personne de ma famille et je n'avais pas honte de ce qui aurait pu paraître comme indécent.
Elle ne pouvait pas ne pas l'avoir sentie, serrés comme nous étions l'un contre l'autre, dans une étreinte que je trouvai sensuelle étant donné mon état et tout ce qui tournait dans ma tête, mais elle ne chercha pas à échapper à ce qui aurait dû être une situation gênante ; elle ne se raidit pas, ne chercha même pas à reculer discrètement pour ne plus ressentir ma gaule contre elle, ne chercha pas à se débarrasser de moi par quelques paroles d'adieu pour me fuir au plus vite. Alors, encouragé par le fait qu'elle prolongeait cette étreinte, je caressai de mes deux mains sa taille, le bas de son dos, très tendrement, et continuant à la humer je lui murmurai dans son cou tanné :
— Vous sentez bon, Marcia. Vous sentez si bon…
Elle ne répondit pas, mais ses mains qui étaient jusque là sur mes épaules et qui étaient restées immobiles me caressèrent le cou, puis la nuque, le bas de la tête, avec douceur, très tendrement, un peu comme une mère caresserait son enfant qu'elle tient serré dans ses bras. Mais je n'avais pas l'âge d'être son fils.
Encouragé par son attitude, j'enfouis ma tête dans sa chevelure brune et fournie, la respirant profondément à son tour, lui murmurant « Vos cheveux sentent bon… », m'attendant toujours à ce qu'elle ouvre ses bras et s'éloigne ; mais elle ne le fit pas et restait là, se laissant caresser. Stimulé, je posai ma bouche entrouverte derrière son oreille et la fis glisser dans son cou, dans un baiser sensuel et avide qui ne laissait plus aucune place à l'équivoque.
Je la sentis frissonner un peu, tressaillir sur ses jambes, creuser ses reins comme si elle ployait, conquise. Ma bouche continua sa course dans son cou sur chaque parcelle de surface laissée libre, puis je la retirai pour venir prendre sa bouche qu'elle ne me refusa pas. Elle l'ouvrit et accueillit ma langue, une langue goulue, affamée, qui explora toute sa cavité buccale, ses lèvres, et suça sa langue profondément.
Mes mains désormais se promenaient sur ses flancs sans vergogne, glissant même vers ses hanches. J'étais rempli d'un désir insatiable d'elle, de son corps de femme, empli d'une envie d'elle irrépressible, et je me pressais fortement contre elle, assouvissant en même temps le besoin impérieux de mon sexe en rut de se frotter contre un corps chaud et féminin, lui faisant sentir quel effet il me faisait, mais également les promesses de ma virilité inassouvie.
Sans me lâcher elle recula jusqu'au réfrigérateur contre lequel je la plaquai. J'embrassais son cou et elle se pâmait, la tête en arrière, murmurant des mots d'encouragement à peine audibles, ses mains s'activant sur mes épaules, dans mes cheveux. Tout son corps transpirait le désir, et c'est désormais elle qui frottait à qui mieux mieux son ventre contre la colonne dure qui restait emprisonnée dans mon slip.
Mes mains palpèrent ses seins qu'elles trouvèrent petits et souples à travers le chemisier. Ma main droite descendit directement entre ses cuisses où elle saisit son sexe que je sentis renflé à travers le pantalon. N'en pouvant plus et tout en la bécotant furieusement, je dégrafai avec hâte sa ceinture, déboutonnai son pantalon gris et le fis tomber à ses pieds. Elle ne protesta pas et me facilita la tâche tout en me rendant mes baisers avec frénésie. Le moment était torride, et j'avais l'impression d'être dans la scène culte du Facteur sonne toujours deux fois. Me laissant tomber à genoux, je fis passer ses pieds chaussés de bottines hors des jambes du pantalon pour l'en libérer, puis, n'y tenant plus, je saisis la petite culotte, la descendis et l'ôtai complètement.
Je me retrouvai en face d'une jolie chatte renflée et garnie d'une toison brune très rase. Posant mes mains à l'intérieur des cuisses, je les lui fis écarter avec douceur et je vis les lèvres s'entrebâiller. Elle accueillit la pointe de ma langue avec un profond soupir tandis que je m'efforçais habilement d'entrouvrir la petite tirelire aux rebords bien ourlés ; je me délectai de son goût musqué de femme tandis que mes mains remontèrent le long de ses hanches douces et saisirent ses fesses pleines. Je fus surpris mais ravi de constater que Marcia était une fausse maigre. Si elle était petite et semblait menue, sa maturité lui avait donné des formes féminines que ses pantalons de ville assez stricts dissimulaient.
Je pelotais ses fesses à pleines mains, les palpant, les massant énergiquement tandis que ma langue montait et descendait sur son coquillage salé ; elle finit par en trouver l'entrée et s'y enfonça, faisant geindre Marcia sans retenue, bouche ouverte. Ma cuisine n'avait pas eu l'habitude de retentir ainsi de cris de plaisir d'une femme ! Mon majeur s'était aventuré dans son sillon fessier et avait également trouvé sa récompense sous forme d'un petit cratère tout lisse qu'il caressa lentement et agaça doucement.
J'avais maintenant ma bouche collée toute entière sur sa chatte, et je la ventousais tandis que ma menteuse allait et venait dans les profondeurs de sa grotte, cherchant à aller toujours plus loin. Mes doigts étaient allés chercher un peu de sève qui débordait de la vulve et en avaient humecté la petite rosette, si bien que mon majeur avait trouvé le moyen de pénétrer lentement mais sûrement l'orifice étroit qui se livrait peu à peu.
Au fur et à mesure que Marcia, qui avait ses mains sur ma tête autant pour la maintenir en place (bien que je n'eusse aucunement l'intention de m'échapper) que pour me caresser les cheveux, fléchissait sur ses jambes presque tremblantes, mon majeur progressait régulièrement en elle, conquérant le petit canal de son cul, étroit et brûlant. Elle réagissait à cette double invasion en poussant des râles de plus en plus hauts, trahissant une excitation intense ; son corps réagissait lui aussi, et elle ondulait des reins, se pâmait, et je sentais sur ma langue et mon majeur les spasmes de sa chair qui révélaient des ondes orgasmiques.
Je finis par abandonner sa chatte onctueuse à regret et je me relevai, mais en ayant toujours mon doigt bien enfoncé dans son cul. Je repris sa bouche et elle m'embrassa profondément et passionnément, avec une fougue que je pris pour de la gratitude.
Pendant ce temps-là, mon majeur ne restait pas inactif, et restant bien enfoncé entre ses fesses il continuait à la fouiller, à lui baiser le cul, ce qui m'excitait comme un malade et était loin de lui déplaire. Ce doigt bien enfoncé en elle, au plus profond d'elle et dans son orifice le plus intime, le plus secret, le plus tabou, était la manifestation évidente du fait qu'elle m'appartenait toute entière, qu'elle s'était offerte, qu'elle s'était livrée et que j'allais la prendre comme une chienne. J'allais lui faire tout ce que j'avais envie de lui faire, j'allais faire tout ce que je voulais d'elle : elle m'était soumise, je la possédais. Tel était en tout cas ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, au niveau le plus haut de mon excitation, dont la preuve physique bien tangible se trouvait comprimée dans mon slip tant je bandais comme jamais.
Elle n'avait rien contre cette possession, manifestement. Elle me prouva d'ailleurs qu'elle était, elle aussi, bien excitée en dégrafant fébrilement ma ceinture, puis en me débraguettant ; elle sortit ma queue qui était tendue et raide comme la justice et la prit dans sa main. Elle la pressa comme pour en apprécier la dureté, la caressa un peu, la branla de haut en bas sans cesser de me galocher. Pendant ce temps, de ma seule main gauche (la main droite s'agitait toujours entre ses fesses) j'entrepris tant bien que mal de lui défaire un à un les boutons de son chemisier.
Lorsqu'elle se laissa glisser à genoux, je dus retirer à regret mon majeur de son anus, mais ce fut pour une bonne cause : elle emboucha le gland rond et gonflé de mon sexe, le suça goulûment comme une friandise. Sa bouche était soyeuse et douce, c'était divin ! Elle commença à l'aspirer plus avant entre ses lèvres pulpeuses puis entama de lents va-et-vient tandis que je faisais passer son chemisier déboutonné par-dessus ses épaules puis m'attelais à dégrafer son soutien-gorge.
Elle m'apparut dans toute sa nudité, ses seins en poire majestueusement posés sur sa poitrine, ses fesses rebondies bien cambrées : elle était terriblement bandante ainsi, à genoux dans ma cuisine, vêtue uniquement de ses bottines, en train de s'appliquer à me sucer en une pipe magistrale, avec ses lunettes sages et sa belle chevelure brune toujours bien coiffée.
Je sentais le plaisir m'envahir, j'étais aux anges ; je n'avais jamais connu d'aussi bonne suceuse, et de voir cette belle agent immobilier d'un âge avancé, d'ordinaire si sérieuse, si professionnelle, en train de pomper son ancien client dans la maison qu'elle lui avait fait obtenir, me rendait dingue d'excitation ! D'autant que je n'avais pas fait l'amour depuis de longs mois et que si les quelques branlettes que je m'octroyais relâchaient régulièrement le trop-plein de tension sexuelle accumulée, rien ne valait les caresses et le corps voluptueux d'une femme, nom de Dieu !
Elle me suçait avec ardeur et dévouement tandis que mes mains lui témoignaient ma gratitude en caressant tantôt sa chevelure souple, tantôt ses seins provocants, malmenant leurs pointes jusqu'à ce qu'elles durcissent, les faisant rouler, les agaçant, les étirant, testant leur élasticité, mettant à mal leur sensibilité, mais sans arriver à lui arracher un cri ou un gémissement : Marcia était manifestement une coriace, une endurante !
Quand je n'en pus plus, je la saisis sous les bras et la fis se relever, l'amenai à ma hauteur et lui repris fougueusement la bouche tout en lui pelotant les fesses ; puis sans lâcher sa langue, je lui collai mes doigts dans sa fourche bien luisante et la branlai du bourgeon jusqu'à l'orifice vulvaire où je fis pénétrer trois doigts, la fouillant convulsivement, entrant bien à fond, lui arrachant des cris étouffés, ma bouche étant toujours refermée sur la sienne, sa langue emprisonnée et sucée avec avidité par mes soins.
Je la pris par la taille et la guidai jusqu'à la table de la cuisine, la faisant ployer sur celle-ci ; elle comprit bien ce que je voulais d'elle et se cambra, appuya ses avant-bras sur le plan en bois et écarta les cuisses.
A ce moment-là, elle tourna la tête et me dit d'une voix rauque et sourde :
— Viens. Prends-moi !
Je n'allais évidemment pas me faire prier ; elle n'allait pas avoir besoin de me le demander deux fois ! Je pris une capote dans le tiroir, la déballai en un temps record, coiffai ma pine toute dure et déroulai le latex dessus.
Son petit cul légèrement fripé était là qui m'attendait, me narguait.
Je posai mes mains de chaque côté de sa taille et la serrai fort, histoire de lui montrer qu'elle m'appartenait en ce moment, et que j'allais la saillir en levrette, comme elle en avait envie.
Ses jolis seins mûrs pointaient vers le bas, tout fuselés, et je bandai de plus belle. Sa chevelure tombait sur sa nuque, et j'avais une envie furieuse de voir tout ça s'agiter sous mes coups de pine !
Mes mains se posèrent sur son bassin, descendirent sur ses fesses qu'elles empaumèrent pour bien s'imprégner de leur agréable volume, les palpèrent avec de légères pressions pour en apprécier la fermeté, sentir le muscle sous le galbe, puis je leur décochai à deux mains des claques sonores et bien sèches qui la firent crier et tressaillir. Pour ponctuer ma courte fessée et adoucir l'effet de la cuisante surprise – et aussi expliquer mon geste auquel elle ne s'attendait pas – je lui lançai :
— J'aime ton cul ! Tu as un beau cul, il me fait de l'effet ! Je vais te baiser, je vais te prendre comme une chienne !
— Oh oui, viens… répondit-elle d'une voix de gorge.
Je lui écartai un peu plus et sans douceur les cuisses, me plaçai juste derrière elle et présentai ma pine à l'entrée de sa belle chatte dont les lèvres ouvertes et baveuses étaient plus qu'une invite. Lentement je l'enfilai et glissai en elle jusqu'à aller buter bien au fond de son vagin. Elle poussa un « Aah… » de plaisir et de pleine satisfaction, m'accueillant comme la pluie après des mois de sécheresse. Son fourreau était étroit, souple et chaud.
Je refermai mes mains sur sa taille, juste au-dessus de ses hanches bien saillantes, la maintins fermement ainsi et commençai à lui donner des coups de boutoir, de plus en plus rapides et de plus en plus fort. Chaque coup de bélier était accueilli par un cri de folle tandis que des mouvements de révulsion de sa nuque agitaient sa belle chevelure. Ses tétons se balançaient comme deux petits battants de cloche, et les plis un peu gras de sa peau (apanage des années) prenaient des ondes de choc.
Je dus ralentir un peu et marquer une pause pour ne pas jouir de suite.
Je ressortis ma pine, la fis coulisser entre ses fesses, histoire de caresser un peu sa rosette brune, de baiser aussi ses petites fesses, lui laissant planer le doute (qu'elle se demande un peu si je n'allais pas l'enculer dans la foulée). Si l'idée de la sodomie m'excite toujours, c'est parfois un peu compliqué ; et puis je dois reconnaître que je prends plus de plaisir dans la chatte d'une femme que dans son cul. Mais cette possession, il faut bien avouer, est quand même une preuve de totale soumission, et cette offrande qu'il ne faut jamais imposer est quand même le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à son amant.
Aussi, bien qu'elle ne s'insurgeât pas contre cette manière annonciatrice d'une enculade imminente, je ne poursuivis pas dans cette voie et réintroduisis ma queue dans sa chatte et me remis à la besogner en cadence, non sans l'avoir attrapée à pleines mains par les seins et la tirant par là en arrière à chaque fois, l'empalant violemment sur ma queue. Ses cris montèrent de plus en plus fort et elle se mit à jouir bruyamment, comme une folle, tandis que je lui mordais l'épaule et le cou en pressant avec force ses mamelons turgescents.
L'air de la pièce était électrique, plein d'une tension sexuelle qu'on aurait pu toucher tant elle était aiguë, proche d'une explosion à laquelle on s'attendait à la moindre étincelle d'excitation supplémentaire. J'avais envie de lui faire mal, de la griffer, de la gifler, de l'assouvir, de la traiter comme ma petite pute, mon esclave sexuelle, mon objet, et pourtant j'étais en même temps transporté de reconnaissance envers elle qui m'avait livré son corps, qui se donnait à moi sans condition. Il semblait en tout cas qu'elle appréciait – dans ce moment torride, ce moment où l'excitation, où l'incendie de nos deux corps avait atteint son paroxysme – un peu de brutalité mâle, des gestes de domination sexuelle et machiste.
Encore une fois, pour ne pas jouir de suite, je me retirai de sa chatte, attrapai Marcia par les cheveux, l'obligeant à se relever de la table puis lui prenant la nuque tandis que je restais debout, et j'amenai sa bouche à ma queue pour la lui enfoncer, l'obligeant à me sucer en restant courbée en avant.
Elle se plia de bonne grâce à mon caprice et me suça avec zèle et avidité un bon moment.
Puis je lui ré-empoignai à nouveau sa belle chevelure, la redressant un peu plus, et prenant ma pine dans l'autre main je me mis à lui fouetter le bout de chaque sein avec le gland, visant bien la pointe, titillant le mamelon, étalant sa propre cyprine luisante sur le téton.
Ce jeu semblait l'amuser et continuait à l'exciter. Puis j'attrapai de nouveau sa tête et lui soufflai :
— Je vais te baiser la bouche.
Je n'attendis ni sa réponse ni son consentement et j'enfonçai à nouveau ma queue raide entre ses lèvres pulpeuses, et tout en agitant sa tête pour des va-et-vient vigoureux coordonnées avec mes coups de reins impétueux, je fis pendant une demi-minute ce que j'avais promis.
Quand je redressai son visage, elle était en sueur, un peu échevelée, et me souriait d'un air entendu. Je la relevai complètement, la fis tourner et me collai contre elle ; une main enserra sa taille, se plaqua sur sa chatte, mes doigts dans sa fente, l'autre main lui pelotant les seins l'un après l'autre avec véhémence.
J'avais ma queue raide entre ses fesses, tout en haut de son sillon (Marcia est petite). Ma bouche lui suçota le cou et je lui dis vicieusement, vachard et vicelard :
— Maintenant je vais te baiser comme un malade, Marcia. Je vais te baiser comme on ne t'a jamais baisée. Je vais t'enfiler, te pistonner, te bourrer, te défoncer… Tu vas être baisée comme une salope !
— Chiche, murmura-t-elle, vas-y !
Mes mains d'abord sur ses épaules, je reculai un peu, m'écartai d'elle puis me mis à la fesser vigoureusement mais pas trop fort ; elle cria et se tortilla, essayant d'échapper aux claques sonores. Puis je lui fis faire demi-tour, posai mes mains sur sa taille et je lui happai le bout des seins que j'aspirai, suçotai goulûment, mordillai, étirai, tétai avec des bruits humides.
Je l'assis sur ma table de cuisine (elle avait déjà mis ses mains sur mes épaules) et la renversai lentement ; je tirai un peu son bassin pour que son cul et sa chatte soient bien dans le vide et m'enfonçai d'un seul coup dans son orifice vulvaire encore bien ouvert. Elle m'accueillit avec un soupir de contentement et installa ses jambes de chaque côté de moi, enserrant ma taille de façon possessive. Je commençai à aller et venir lentement, en de longs mouvements souples et profonds jusqu'en butée. Je la regardais droit dans les yeux, ses beaux yeux clairs, et elle me regardait intensément en souriant légèrement. Je la baisais avec amour, avec un plaisir inégalé ; je prenais mon pied.
Je lui dis :
— Tu es bonne, vraiment très bonne. J'adore te baiser, Marcia. Je prends mon pied comme jamais.
Elle me sourit et dit de sa voix un peu nasillarde :
— C'est bon pour moi aussi. Tu me baises bien. Tu me donnes beaucoup de plaisir. J'adore comme tu me baises.
Je caressais ses fesses, son anus. J'avais envie de lui fourrer un doigt, de forcer son petit anneau souple, mais j'y insérai à peine le bout de ma phalange, juste pour la narguer, la provoquer. Elle ferma à demi les yeux et soupira. Je relevai ses belles cuisses pour les mettre à la verticale, posant ses bottines de chaque côté de ma tête, et me mis à la besogner de plus en plus vite, de plus en plus fort, tout en la fixant intensément, guettant ses réactions.
Sa bouche s'entrouvrit ; je pouvais lire le trouble dans ses yeux qui se fermaient à demi, son regard qui s'égarait dans le vague : elle partait. Je lui donnai des coups de boutoir de plus en plus forts, lui arrachant des cris qui devinrent de plus en plus intenses, des cris de plaisir qu'elle lâchait désormais sans aucune retenue.
Elle se faisait baiser sur ma table de cuisine ! Ce spectacle m'excitait en diable… Cette femme qui paraissait si sage quand on allait la voir dans son agence, elle au maintien si sérieux, si élégante, si posée, elle était en train de prendre son pied comme une salope et, putain, qu'est-ce qu'elle me faisait comme effet !
Je ne pus me retenir plus longtemps. Tout en lui pressant les seins, au milieu de ses cris de jouissance aigus qui emplissaient la pièce, je rugis comme un dément et envoyai toute la purée en elle en lui mordant la cuisse. Nous restâmes quelques secondes figés dans la même position, comme anéantis, moi en elle, ses jambes en l'air, tandis qu'elle reprenait avec peine son souffle.
Ce fut elle qui prononça la première parole :
— Eh bien, si je m'attendais à ça… On peut dire que c'était une super partie de jambes en l'air. Et quel baiseur !
— Merci, répondis-je un peu gêné. Faut dire que vous me faites beaucoup d'effet…
— J'ai vu ça !
Nous passâmes à la douche. Je lui proposai de la savonner mais elle déclina l'invitation. Un reste de pudeur, sans doute. Puis elle se hâta un peu, rappelant que son mari l'attendait pour dîner. Elle avait l'habitude de rentrer tard du travail, mais quand même…
Nous parlâmes peu. Je la raccompagnai jusqu'à la porte. Au moment de la quitter, j'avais encore envie de la remercier, mais j'avais le sentiment que ça aurait paru un peu déplacé : elle avait pris son pied ; elle ne m'avait pas fait don de son corps par abnégation. Elle en avait eu envie et n'avait pas été déçue.
Je lui dis juste :
— Ma porte vous est, et vous restera, toujours ouverte, Marcia.
— La mienne aussi, répondit-elle avec un clin d'œil coquin et du tac-au-tac.
— Ohhh… cochonne ! rigolai-je en la laissant partir avec une caresse dans les cheveux.
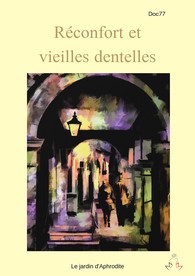 Retrouvez ce texte en édition numérique au format .pdf ou au format .epub. Le téléchargement est gratuit.
Retrouvez ce texte en édition numérique au format .pdf ou au format .epub. Le téléchargement est gratuit.Vous pouvez également télécharger d'autres publications sur la page des ebooks.




